Vos modes d'expression sont nombreux. Quel est le déclic qui a déclenché chacune de vos activités ?
Une activité en a partiellement engendré une autre, mais il est vrai qu'il y a eu une succession de déclics. Pour moi, le dessin était une évidence : ma mère était peintre, mon père architecte. Quand j'étais gamin, je pensais que j'étais obligé d'être architecte comme mon père, et j'en souffrais beaucoup. J'étais mauvais en maths, or pour être architecte, il fallait être bon en maths. En réalité l'architecture ne m'intéressait pas tant que ça. Même si mes parents n'étaient pas autoritaires, j'étais un bon garçon bien élevé, et je me sentais obligé moralement de suivre leur désir. À un moment donné, j'ai fait une sorte de "crise" qui m'a enlevé ce poids de la poitrine : j'ai affirmé que je voulais être peintre, pas architecte. Le jour où j'ai dit cela, une de mes tantes était présente et m'a dit : "mais non, tu n'es pas obligé d'être architecte." Là, j'ai compris qu'on pouvait choisir, qu'on n'était pas obligé de faire ce que nos parents voulaient qu'on fasse. Je me suis donc orienté naturellement vers le dessin, que je pratiquais déjà : mon père me donnait à volonté de grands blocs de papier à dessin, je dessinais dans les marges de mes cahiers.
J'ai eu mon bac en 1969, mai 68 était passé par là et je m'intéressais à la politique. J'ai commencé par l'Université de Vincennes, où j'ai fait de l'affiche révolutionnaire et de la figuration narrative - le nom un peu snob de la bande dessinée. Le prof était Moebius, il a été ensuite remplacé par Mézières. Je suis resté deux ans à Vincennes, puis le bruit a couru qu'aux Beaux-Arts de Paris, on créait un atelier de bande dessinée sous la direction du sculpteur catalan Marcel Gili. Il ne connaissait rien à la BD, mais il pensait qu'il y avait là une opportunité de faire venir des gens intéressants. C'était en 1973, et effectivement des jeunes artistes passionnants sont arrivés, parmi lesquels les futurs membres du groupe Bazooka. Je me suis tout de suite rapproché d'eux, tout en restant un peu en marge, car je sortais d'un groupuscule maoïste, et je n'avais nulle envie de m'engager dans un nouveau groupuscule où il y avait une atmosphère un peu lourde d'auto-critique. En plus ces gens avaient un penchant pour les drogues dures, et j'étais déjà conscient de la nécessité de protéger mon corps. Je me suis cantonné aux drogues douces, et je me suis séparé de ce groupe au moment où ils avaient des positions agressives envers leurs employeurs. C'était bien en un sens, subversif, mais ça n'était pas dans mon caractère.
J’ai également participé à l’aventure Métal Hurlant, le légendaire magazine de BD publié par les Humanoïdes associés. Je suis allé voir Massin, qui était à l'époque directeur artistique chez Gallimard, et qui m'a donné du travail tout de suite. Je suis vite devenu un familier de la maison dès la fin des années 70. J'ai également illustré une collection, "Nuits blêmes", chez 10/18. Jean-Claude Zylberstein m'avait présenté à Christian Bourgois. À l’époque, 10/18 avait la réputation d'être un éditeur exigeant pour les maquettes de ses couvertures, c’était donc une expérience intéressante.
 |
| Phuong Dinh Express, premier roman de Romain Slocombe |
Le Japon semble indissociable de vos sujets de prédilection en matière de photo.
Pendant les années 90, je suis allé 19 fois au Japon, qui est presque un pays d'adoption. Je parle la langue, je suis marié à une Japonaise, j'ai une fille eurasienne. À cette période-là, le Japon était en pleine crise économique, et tous les côtés noirs des perversions japonaises revenaient en force. D'où le succès de mes photos là-bas : beaucoup de filles venaient s’y faire photographier dans des mises en scène « bondage », j'y ai vécu des histoires assez loufoques ... Ces expériences-là ont d'ailleurs beaucoup inspiré mes romans ultérieurs : elles ont donc constitué une sorte de déclic vers la littérature.
Plusieurs de vos romans ont été publiés en Série noire. Comment cela s’est-il passé ?
J'ai fait une expo de photos en 93 ou 94 à Paris, et Patrick Raynal y est venu. Il venait d'entrer comme directeur de la Série noire chez Gallimard, et il m'a demandé un polar sur le Japon. J'étais très flatté bien sûr, j'avais une vague idée de ce que je pouvais faire, mais je ne suis pas allé au bout. Plusieurs années plus tard, une amie qui travaillait chez Denoël m'a demandé un roman contemporain situé au Japon pour une collection. J'ai commencé à écrire Un été japonais en 1999, et petit à petit je me suis aperçu que ce roman tournait au polar. Je me suis mis à regretter de ne pas l'avoir fait pour Patrick Raynal. Coup de chance : le directeur de Denoël n'a rien compris au livre et l'a plus ou moins refusé. J'ai donc foncé chez Gallimard, je l'ai déposé chez Patrick Raynal qui l'a accueilli à bras ouverts. Il m'a donc fallu 17 ans pour écrire mon deuxième roman pour adultes.
Car entre-temps, j'ai écrit quelques livres pour enfants chez Syros et ailleurs, continué la photo et le dessin. Mais là, avec Un été japonais, je me suis créé une sorte d'alter ego en la personne de Gilbert Woodbrooke, et j'avais envie d'écrire d'autres histoires avec ce personnage. J'ai proposé l'idée à Patrick Raynal, avec le projet de faire les 4 saisons du Japon. Je lui ai donc livré très vite le deuxième, Brume de printemps, qui est sorti l'année suivante. Le troisième, Averse d'automne, a paru en 2003. Un été japonais a été très remarqué, il a eu beaucoup de presse. Curieusement, pour ce roman, j'ai eu de la presse... sans attachée de presse ! J'ai donc publié les trois romans de cette suite à la Série noire. Puis Patrick Raynal a été remplacé à la tête de la collection par Aurélien Masson, qui a voulu transformer complètement le quatrième roman de la série, Regrets d'hiver. Il m'a rendu le manuscrit avec pratiquement un post-it par page, plus un cahier de lecture... C’est quelqu’un qui travaille beaucoup les manuscrits – qui les travaille trop à vrai dire – avec des statistiques sur le nombre de parenthèses par exemple...
J'ai donc décidé de m'extirper de cette situation pour signer chez Fayard, avec Patrick Raynal. Où malheureusement le quatrième volume de la tétralogie puis les trois volumes de la série suivante, L'Océan de la stérilité, paraîtront sans visibilité... J'en suis très content au niveau des textes, mais non seulement ils ne sont pas sortis en poche, mais en plus ils ont eu très peu de presse. Du coup mon public s'est limité aux quelques aficionados qui me suivaient.
Dans votre travail graphique - dessin ou photo - vous explorez beaucoup le bondage, les blessures, la maladie. Ces aspects de vos choix artistiques ont-ils pu effrayer certains lecteurs ?
Non, je ne pense pas. Mon univers visuel, même s'il entretient des rapports étroits avec mes romans, ne coïncide pas entièrement avec mon univers littéraire. Pour faire une analogie, on pourrait parler de l'œuvre de Léo Malet. Si on est attentif, on s'aperçoit qu'il y a un véritable fétichisme de la lingerie féminine chez lui. Mais ce n'est pas ce qui s'en dégage principalement : Malet, c'est surtout une certaine étrangeté un peu surréaliste, des atmosphères, des scénarios très noirs. Au passage, c'est vrai, on va insister un peu sur ce que porte en dessous la secrétaire de Nestor Burma. C’est la même chose dans mes romans : il y a des rêves étranges, des filles qui ont des accidents, mais ce sont des passages presque furtifs, où se révèle mon univers. Et puis certaines personnes adorent mes livres mais se contrefichent des photos ou des dessins. D'autres connaissent bien mon univers visuel, mais ne lisent pas mes romans, parce qu'ils ne lisent pas beaucoup, tout simplement.
J'ai vu dans une biographie que vous aviez traduit en anglais le Tombeau pour 500 000 soldats, de Pierre Guyotat. C'est extrêmement surprenant, c'est une œuvre qui passe volontiers pour difficile, et éventuellement intraduisible. Pouvez-vous m'expliquer comment c'est arrivé ?
Je ne connaissais pas Guyotat à l'époque, et un éditeur anglais un peu pirate, qui publiait mes livres de photo en Angleterre et qui savait que j’étais bilingue, m'a demandé de traduire le Tombeau. Sans doute que je lui coûtais moins cher qu'un traducteur "officiel"! J'ai accepté de le faire, et ça a duré assez longtemps, c'est vrai. C'était d'autant plus déconcertant au départ que je devais travailler dans le sens inverse de mon habitude, du français vers l'anglais. Et puis curieusement, ça fonctionnait bien. L'écriture de Guyotat, avec la position bizarre des virgules, passe très bien en anglais, et la poésie surgit un peu de la même manière qu'en français. Le livre a été publié, et c'est d'ailleurs la seule version anglaise qui subsiste de Tombeau. Il y en avait eu une un peu avant, mais la traduction a brûlé. C'était une grande traductrice anglaise qui avait fait le travail, et sa maison a brûlé, rien n'a subsisté, et l'éditeur n'avait aucun élément... Donc cette traduction n'est jamais sortie. Du coup, je suis devenu un peu ami avec Guyotat à l'époque. Mais son univers est gay, et très intellectuel : il a une reconnaissance forte chez les intellectuels. Ça n'était pas vraiment mon univers. J'ai beaucoup aimé Tombeau : même s'il y a beaucoup de visions homosexuelles, il y a aussi beaucoup de visions hétérosexuelles !
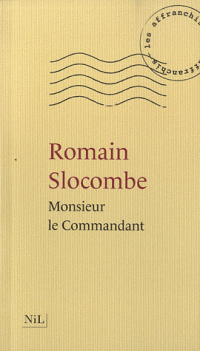 Passons à Monsieur le Commandant, le titre qui vous a fait connaître du grand public. Comment vous est venue l'idée de ce roman ?
Passons à Monsieur le Commandant, le titre qui vous a fait connaître du grand public. Comment vous est venue l'idée de ce roman ?Une jeune éditrice, Claire Debru, m'a contacté sur Facebook car elle lançait chez NiL la collection « Les Affranchis », des romans épistolaires. Elle avait des goûts très éclectiques, puisqu'elle avait également sollicité Annie Ernaux, Linda Lê et d’autres. Cette demande est tombée au moment où j’avais retrouvé un texte très émouvant de ma grand-mère paternelle, que je n'ai jamais connue, et qui racontait la vie d'une Française sous l'Occupation, en province. J'avais déjà écrit sur la Shoah, notamment dans mon roman Qui se souvient de Paula ?, sorti chez Syros en 2008, qui racontait l'histoire d'une étudiante juive fille d’un peintre polonais, qui passe la ligne de démarcation et se retrouve à Paris au pire de l'Occupation, essayant à la fois de retrouver son père et de fuir les nazis.
 À partir du moment où j'ai découvert que ma grand-mère russe était juive, ce qui était bien caché dans la famille, je me suis senti le droit de parler de ce sujet. J'ai donc commencé à réfléchir à une époque que je connaissais assez mal mais que j'avais envie d'approfondir. Je me suis documenté de façon très rigoureuse et abondante. Et j'ai su tout de suite que le livre serait une lettre de dénonciation : tout de suite, la nature de la lettre indiquerait la nature du personnage... Comme il fallait que la lettre soit suffisamment longue pour constituer un roman, j'ai décidé que le héros serait un écrivain, qui pouvait être assez bavard pour se laisser entraîner par son histoire et la raconter bien. Le thème du livre, tuer ce qu'on aime, m'a toujours fasciné. J'ai imaginé tout de suite que cet homme allait dénoncer celle dont il était amoureux, et qui en plus portait son enfant. Une fois ces idées acquises, j'ai dû construire le roman, la famille, trouver le langage et les idées politiques : je voulais vraiment faire le portrait d'un pétainiste pro-allemand. Ce langage un peu faux-cul qu'il utilise, il m'est arrivé de l'entendre chez mes parents, dans la bouche de grands bourgeois. J'ai notamment eu l'occasion d'entendre parler Jean Leguay, l'adjoint de Bousquet qui a organisé le départ des enfants juifs. Je me souviens très bien de lui, de sa façon de parler. J'ai également entendu la voix de Jacques Chardonne, extrêmement prétentieuse, à la radio, pendant une interview d'Olivier Assayas par Laure Adler.
À partir du moment où j'ai découvert que ma grand-mère russe était juive, ce qui était bien caché dans la famille, je me suis senti le droit de parler de ce sujet. J'ai donc commencé à réfléchir à une époque que je connaissais assez mal mais que j'avais envie d'approfondir. Je me suis documenté de façon très rigoureuse et abondante. Et j'ai su tout de suite que le livre serait une lettre de dénonciation : tout de suite, la nature de la lettre indiquerait la nature du personnage... Comme il fallait que la lettre soit suffisamment longue pour constituer un roman, j'ai décidé que le héros serait un écrivain, qui pouvait être assez bavard pour se laisser entraîner par son histoire et la raconter bien. Le thème du livre, tuer ce qu'on aime, m'a toujours fasciné. J'ai imaginé tout de suite que cet homme allait dénoncer celle dont il était amoureux, et qui en plus portait son enfant. Une fois ces idées acquises, j'ai dû construire le roman, la famille, trouver le langage et les idées politiques : je voulais vraiment faire le portrait d'un pétainiste pro-allemand. Ce langage un peu faux-cul qu'il utilise, il m'est arrivé de l'entendre chez mes parents, dans la bouche de grands bourgeois. J'ai notamment eu l'occasion d'entendre parler Jean Leguay, l'adjoint de Bousquet qui a organisé le départ des enfants juifs. Je me souviens très bien de lui, de sa façon de parler. J'ai également entendu la voix de Jacques Chardonne, extrêmement prétentieuse, à la radio, pendant une interview d'Olivier Assayas par Laure Adler. Ces écrivains de droite du début du XXe écrivaient très bien d'ailleurs : du coup, pour m'imprégner de ce style particulier, j'ai lu beaucoup de livres de Pierre Benoît, même de François Mauriac. Et j'ai créé le personnage de Husson. J'ai donc passé plusieurs semaines à lire ces auteurs. Une démarche que j'avais déjà adoptée pour un livre précédent : j'avais lu beaucoup d'auteurs du XVIIIe (Les Liaisons dangereuses, les mémoires de Casanova, Manon Lescaut, Les Confessions, La Religieuse...). Un exercice que je conseillerais à tous les écrivains... Le XVIIIe plutôt que le XIXe, car quand on lit Dumas ou Zola, on s'aperçoit qu'ils tirent un peu à la ligne, étant feuilletonistes. Leur français est très beau, mais il y en a trop. Tandis qu'avec les auteurs du XVIIIe, on retrouve une tenue, un charme, une mélodie très particulière.
Comment avez-vous réagi au succès de Monsieur le Commandant ?
Ce succès a pris beaucoup de temps. Au début, il n'y avait pas du tout de presse, un peu en province mais rien du tout à Paris. On s'arrachait les cheveux. Et puis l'attachée de presse a fait un effort supplémentaire, elle a appelé François Busnel qui m'a invité à la "Grande librairie". Franz Olivier Giesbert a lu le livre et l'a aimé, Elkabbach m'a invité à son émission. Et puis Tahar Ben Jelloun a fait beaucoup en affirmant que mon livre était le meilleur de la rentrée littéraire, et du coup il m'a fait entrer sur la première liste du Goncourt. Mais comme Bernard Pivot me déteste ... déjà il ne voulait pas que je figure sur cette première liste donc évidemment... Giesbert m'a offert une pleine page dans Le Point, Ruquier m'a invité à son émission et alors là, ça a été le décollage immédiat. Du coup, je suis maintenant dans une position plus confortable. Avec mon nouveau livre, j'ai des articles dans la grande presse plus facilement. Et le fait d'être publié au Seuil, dans une très belle collection, joue aussi un rôle important. Cette collection peut vraiment devenir la Rolls du polar dans les années à venir.
Comment êtes-vous passé du roman noir au roman d'espionnage avec Première station avant l'abattoir?
À cause d'Eric Ambler, que j'adore et que j'ai découvert grâce à Jean-Pierre Dionnet, qui a été le premier à le publier en France. J'ai toujours beaucoup aimé les films des années 30, les premiers Hitchcock par exemple. Et mon côté anglais a eu son rôle à jouer sans doute. Sans parler bien sûr de l'histoire extraordinaire de mon grand-père journaliste de gauche pendant l'entre-deux guerres. Il a interviewé Hitler et Mussolini, quand même ! Et puis j'ai découvert sur internet il y a deux ans une phrase qui impliquait que mon grand-père aurait fait de l'espionnage. J'ai remonté la piste, et ça a été une découverte formidable ! Cela m'a donné envie d'écrire un livre où le héros lui ressemblerait. Je me suis demandé ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. À l’époque, il avait une très belle voiture, des maîtresses, une maison de campagne, et il menait la grande vie dans les bars de Montparnasse. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'en ai déduit que mon grand-père avait beau être un journaliste pro-bolchevique, il était quand même très attaché à la France. J'ai donc imaginé qu'il utilisait à des fins personnelles l'argent qui lui était confié pour corrompre les politiciens français. Il n'avait pas besoin de les corrompre, puisqu'il était suffisamment bien informé lui-même ! D'autant qu'à l'époque, l'espionnage n'était pas encore une science exacte.
Donc mon personnage est presque un imposteur : quand il part pour Gênes, il est très angoissé à l'idée de rencontrer la police secrète russe. Je me suis amusé à faire de petits clins d'œil à Eric Ambler. J'ai relu ses 6 premiers romans, qui ont un côté très romanesque, une intrigue assez simple, mais une ambiance très typée, des colonels des services secrets, des espions. En plus pour Ambler, qui était de gauche, les bons sont les Russes, ce qui est un peu atypique chez les auteurs de romans d'espionnage. J'ai repris par exemple la scène de l'opéra, les scènes de train. Quant aux policiers qui attendent Exeter dans sa chambre d'hôtel, c'est une allusion à Somerset Maugham.
J'ai voulu apporter quelque chose que Ambler n'avait pas : il n'avait pas de recul historique, pas de connaissance sur la vie réelle des agents secrets russes, et même une certaine naïveté. J'ai voulu m'intéresser à qui étaient vraiment les agents secrets russes, aux conflits entre les staliniens et l'aile gauche du parti. Je me suis donc beaucoup documenté sur cette période, sur les trafics de bijoux entre autres, et aussi sur les révélations sur la jeunesse de Staline, et sur ce personnage fascinant qu'est Reilly-Rosenblum. J'ai alors pu mettre en place tous ces éléments d'histoire à Gênes en 1922 et dans ce palace de la Riviera italienne où est logée la délégation soviétique.
Certains de vos romans vont bientôt être traduits en Anglais chez Gallic Books. Est-ce que cela constitue une étape déterminante dans la carrière d’un écrivain ?
C'est en tout cas très difficile à obtenir pour un auteur français, car les Anglais « importent » très peu de littérature étrangère. Maintenant qu'il existe une version en anglais de Monsieur le Commandant (admirablement traduit par Jesse Browner), beaucoup de gens, et pas uniquement les anglo-saxons, pourront le lire. J'espère que cela m'apportera des traductions de ce roman dans d'autres pays, après l'Italie, le Portugal, Israël, la Grèce qui ont déjà acheté les droits...
Vos projets ?
J'écris un nouveau roman pour NiL, où il y aura aussi des espions russes, mais qui sortira en collection "blanche". Même si en ce qui me concerne je ne fais pas vraiment la différence entre littérature "blanche" et littérature "noire", c'est surtout une question d'étiquette dépendant de la maison d'édition. En réalité tous mes romans sont noirs, sans être des polars au sens classique du terme. Et j'espère bien faire revenir Ralph Exeter pour de nouvelles aventures aux éditions du Seuil. Exeter en proie à la tentation : devenir agent double, travailler pour les deux côtés en même temps ? Pourquoi pas...










Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire